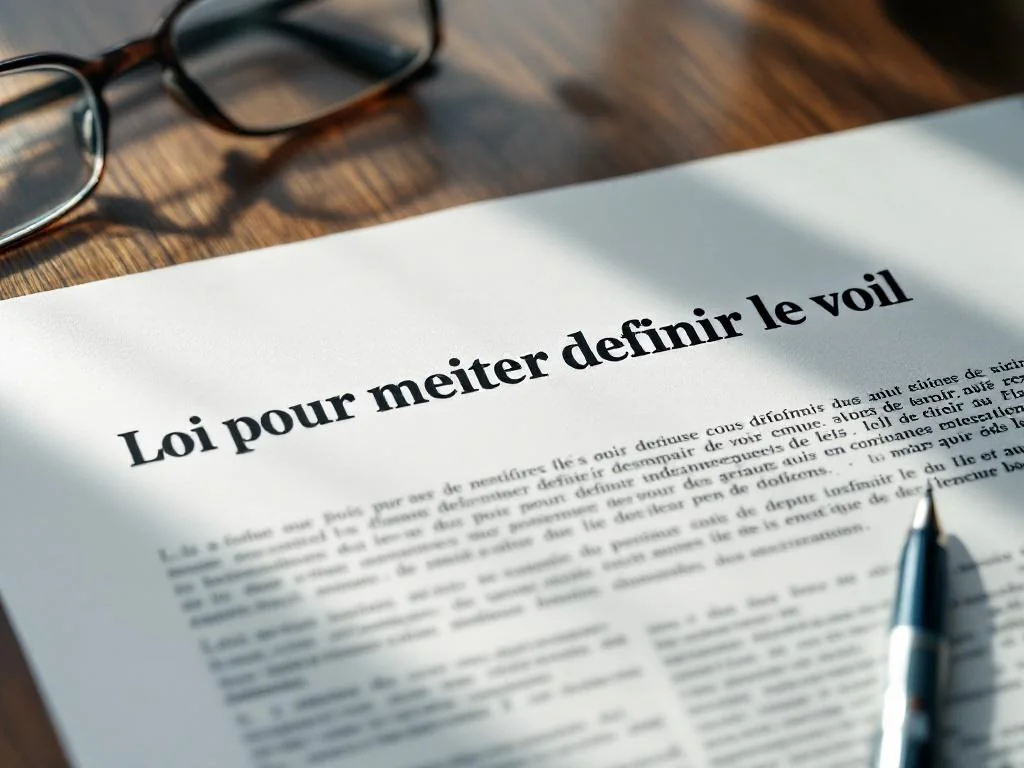Une loi pour mieux définir le viol et renforcer la lutte
Une proposition de loi pour mieux définir le viol
L’Assemblée nationale doit examiner ce jeudi 23 octobre une proposition de loi visant à intégrer la notion de non-consentement dans la définition pénale du viol. Après un accord mardi en commission mixte paritaire, cette modification pourrait être adoptée définitivement. Actuellement, selon le code pénal, le viol est considéré comme tel lorsqu’il est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. La nouvelle loi propose de le définir comme « tout acte sexuel non-consenti ».
Le texte précise que « le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et qu’il « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Un accord pour une nouvelle approche
Les parlementaires ont trouvé un consensus mardi en commission mixte paritaire. La proposition, portée par les députées Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, et soutenue par la ministre à l’Égalité, Aurore Bergé, doit être votée jeudi à l’Assemblée, puis au Sénat le 29 octobre. Si adoptée, elle entrera en vigueur rapidement.
Depuis 2023, cette initiative est en réflexion au sein d’une mission parlementaire. Son objectif est d’intégrer la notion de consentement dans le droit pénal, ce qui fait encore débat parmi les juristes et les associations féministes.
Les enjeux du changement
Marie-Charlotte Garin, députée écologiste du Rhône et co-rapporteure du texte, explique ce que pourrait changer cette loi si elle est adoptée. Elle insiste sur l’impact pour les victimes : la définition actuelle, centrée sur la violence ou la contrainte, est trop restrictive et ne reflète pas toujours la réalité des viols. En conséquence, 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite.
Une meilleure compréhension du consentement pourrait permettre de qualifier plus de faits, d’accroître la reconnaissance des victimes et d’accélérer les condamnations des agresseurs.
Une évolution sociétale et culturelle
Au-delà du cadre juridique, cette réforme a une portée sociétale. Elle répond notamment au mouvement #MeToo, qui a permis une prise de conscience collective. La loi, en intégrant la notion de non-consentement, souhaite aussi poser une première pierre dans la lutte contre l’impunité et les violences sexuelles.
Le cadre actuel est-il insuffisant ?
Selon Marie-Charlotte Garin, le cadre actuel reste insuffisant car il laisse une place au silence ou à la sidération, qui peuvent être exploités par les agresseurs. La nouvelle rédaction précise que le consentement doit être « libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable » et ne peut être déduit d’un silence.
Elle rappelle aussi que, jusqu’à présent, seuls certains magistrats formés sur ces questions pouvaient prendre en compte cette notion dans leurs décisions. La majorité des tribunaux n’appliquaient pas encore cette approche de manière uniforme, ce qui était inacceptable.
Une responsabilité partagée pour le consentement
Une crainte exprimée par certains parlementaires, associations ou avocats, concerne la possibilité que cette loi focalise l’attention sur le comportement de la victime plutôt que sur celui de l’agresseur. Marie-Charlotte Garin répond que le texte a été écrit pour placer la victime au centre, tout en demandant aux magistrats de remettre en question la responsabilité de l’auteur, notamment en lui demandant quelles mesures il a prises pour vérifier le consentement.
Elle insiste aussi sur le fait que la jurisprudence, même ancienne, évoque déjà la volonté libre, mais que cela n’a pas toujours été appliqué dans la pratique. La loi doit s’appuyer sur cette jurisprudence, tout en étant renforcée par des moyens et une formation accrue du personnel judiciaire et policier.
Une prise de conscience après le procès de Mazan
Marie-Charlotte Garin évoque également l’impact du procès des agresseurs de Gisèle Pelicot. Cet événement a permis une meilleure prise de conscience de la culture du viol, notamment que ces violences ne concernent pas seulement des inconnus, mais aussi des proches, des membres de la famille ou des personnes rencontrées dans la vie quotidienne.
Elle rappelle que cette réalité est systémique et qu’il faut continuer à faire preuve de courage pour la reconnaître et la combattre, car ces violences sont malheureusement présentes partout, y compris dans nos foyers.